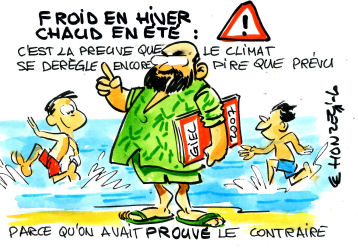|
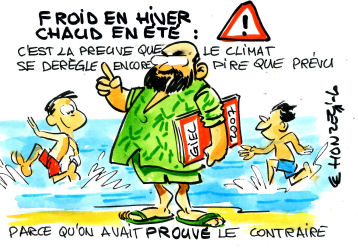
01
avril 2010
Extrait d’un article de
Serge Galam : physicien et
sociophysicien
Climat :
c’est le GIEC qui aura fondu, et avant
2035 !
Les déboires
récents et répétés du GIEC
nous offrent la
possibilité d’un recul
bénéfique pour évaluer les tenants et
les aboutissants,
à la fois de la double question du réchauffement
climatique et de sa cause, et
surtout de la validité de la procédure
utilisée pour y répondre. Face à un
problème qu’on nous affirme être
d’une envergure inégalée, justement
parce
qu’il y aurait urgence, il est vital de prendre son temps
pour minimiser le
risque de se lancer, monde baissé, dans une direction qui se
révèlerait être
fausse. Car se focaliser sur une réduction drastique du CO2,
non seulement ne
résoudrait rien, mais surtout pourrait réduire
notre capacité à réagir dans ce
qui se découvrirait plus tard être la bonne
direction. On est encore très loin
de la voiture électrique pour tous… et les
climato-alarmistes nous disent que,
dans 20 ans, il sera trop tard.
N’oublions pas que si nos
ressources naturelles sont
limitées, nos ressources humaines et financières
le sont encore plus. Tout ce
qui est et sera investi dans la réduction de CO2 ne le sera
pas pour de
nombreux problèmes immédiats, urgents et avec des
solutions connues. Vouloir
garantir un monde vivable aux petits-enfants est certes louable, mais
ne doit
pas se faire au détriment des adultes actuels. Et en plus,
on ne sait pas ni de
quoi sera fait le climat d’après-demain, ni quel
sera l’effet d’une réduction
de notre production de CO2.
Ce sont nos capacités de
réaction immédiate face à des
catastrophes naturelles qu’il faut développer
plutôt que se focaliser sur une
plus qu’une hypothétique action sur le climat du
prochain siècle.
En matière de culpabilité
90 % de certitude,
c’est 0% de preuve
Les climatologues du GIEC soutiennent
que leurs affirmations
sont sûres à 90 %. Mais le climat de la
terre est un phénomène unique,
attaché à un objet unique, la terre, qui ne se
prête pas aux approches
scientifiques habituelles. La méthode
« à historique »,
celle qui ne
dépend pas des conditions initiales de formation de
l’objet étudié, appliquée
en particulier en physique, ne s’applique pas au climat, qui
justement dépend
des conditions de son histoire et de tous les facteurs qui
interviennent aux
différentes étapes de son évolution,
eux-mêmes étant fonctions d’un grand
nombre d’autres facteurs. Si avec la
météorologie nous sommes en mesure de
prédire ce qui va se passer demain avec une barre
d’erreur qui reste
importante, nous ne sommes pas capable de prédire ce que
sera l’évolution du
climat dans les cent ans à venir, et pour cause, aucune
statistique ne peut
être appliquée, faute
d’échelles de temps accessibles.
De surcroît, la
climatologie n’est pas une science dotée
d’un pouvoir heuristique dont la fiabilité a
été mesurée, même si elle
utilise
des méthodes scientifiques. Elle ne peut pas faire de
prédiction falsifiable
par l’expérience, et elle n’a pas fait
de prédictions sur le futur, qui ont
ensuite été évaluées par
rapport à la réalité, pour mesurer son
degré de
fiabilité. Dans sa version moderne, la climatologie est une
science toute jeune
alors que ces échelles de temps caractéristiques
sont au minimum de l’ordre
d’une cinquantaine d’années. Il lui
faudra plusieurs siècles pour acquérir un
statut de science prédictive à la
fiabilité connue. Les modèles actuels de
l’évolution du climat nous permettent certes
d’avancer et de comprendre
certains des phénomènes en jeu, mais nous ne
pouvons pas en tirer de
conclusions définitives sur un engagement fort à
long terme. C’est regrettable
mais c’est un fait.
La culpabilité humaine est rassurante
 cliquez pour lire la suite cliquez pour lire la suite
S’agissant de la question
de la preuve, la culpabilité
humaine est la seule visée. Mais, comme dans un
procès d’assises, une personne,
qui a tout contre elle, n’est pas forcément
coupable, 90 % de certitudes
correspondent à 0 % de preuves. Il est fondamental
de ne pas confondre les
apparences avec la réalité. Il est fondamental de
ne pas confondre un modèle
avec la réalité. Il est fondamental de ne pas
confondre les croyances
majoritaires des scientifiques avec la validité
scientifique. Cette culpabilité
humaine nous arrange, elle nous rassure, mais elle n’est pas
établie. Ce n’est
pas parce que l’homme est coupable de bien des maux,
qu’il l’est forcément de
tout mal. Ce n’est pas parce que l’homme est
tellement présomptueux dans sa
capacité destructrice qu’il détermine
l’évolution globale de la planète.
À
l’inverse, je n’ai pas à prouver que
nous ne sommes pas responsables. Il ne
faut pas inverser la logique d’argumentation, la charge de la
preuve est à
l’accusation. On ne peut pas prouver l’inexistence
de ce qui n’existe pas. On
ne peut pas prouver l’inexistence des fantômes.
Les climatologues sont dans une logique monopoliste
La communauté des
climatologues, naguère peu développée,
s’est transformée en quelques années en
une véritable entreprise multinationale
dotée d’organismes unitaires qui parlent
d’une seule voix. Grâce à un lobbying
politique et médiatique efficace, elle s’est
installée dans une logique
d’entreprise monopoliste qui défend son pouvoir et
ses intérêts. Elle a réussi
à imposer à l’opinion publique et aux
politiques sa « vision » de
l’évolution du monde. Loin de favoriser la
recherche, ce type d’organisation,
unique en science, bloque son libre développement.
Il est important de
préciser qu’il ne s’agit pas
d’une considération
complotiste, mais d’un phénomène
spontané d’organisation, qui ensuite
génère sa
propre dynamique de façon naturelle. C’est de
l’auto organisation, sans comité
qui piloterait le tout. Et c’est justement ce qui rend sa
dynamique dangereuse,
comme l’a révélé le
récent
« climategate », qui a mis au
jour les
petits arrangements entre climatologues alarmistes, pour
préserver ce qui s’est
cristallisé comme étant la
« ligne officielle » du GIEC.
C’est une des questions
essentielles, il n’y a pas à proprement
parler d’invention d’un processus de
réchauffement imaginaire, mais une série
de sauts cognitifs entre ce qui est prouvé, ce que
l’on croit devoir être vrai,
et le désir d’alerter le monde sur une catastrophe
dont on est convaincu
d’avoir prouvé la réalité.
Ensuite, ce sont l’emballement émotionnel et
l’enferment dans la réalité des
modèles qui fabriquent une vision idéologique
du phénomène. Celle-ci, une fois
constituée s’attaquera aux faits réels
qui
pourraient l’invalider provoquant une fuite en avant, avec in
fine une possible
dérive totalitaire.
Alors que le principe
démocratique de l’organisation
politique repose sur le consensus ou l’expression
majoritaire, la science ne
peut négliger le moindre résultat qui la
contredit. Il suffit d’une expérience
pour invalider une théorie scientifique qui s’est
pourtant révélée exacte pour
des milliers d’autres expériences. La
procédure de synthèse sur laquelle se
fonde le GIEC est donc par sa nature même anti-scientifique.
La science est
amorale, elle n’est pas démocratique et ne se
décide pas, ni à l’unanimité
ni
au consensus. La science se prouve, un point c’est tout.
Le climat et la pollution sont deux choses
différentes
 cliquez pour lire la suite cliquez pour lire la suite
Ne mélangeons pas tout. La
lutte contre la pollution, le
gaspillage, les inégalités ainsi que
l’optimisation de nos ressources
naturelles sont des problèmes prioritaires importants pour
notre bien être
d’humains, qui relèvent du politique et de
l’étique, mais pas de la science.
Mélanger ces deux questions aboutit à les rendre
toutes deux insolvables.
Tout amalgame entre ce qui a
été prouvé et ce qui est
perçu
comme devant être vrai, fût-ce par des
scientifiques, n’est que pure idéologie,
dès lors qu’il est placé dans un
contexte social. Cadrer la problématique
climatique sur un terrain émotionnel est dramatique, car en
nous accusant de
« tuer » la planète,
elle nous projette dans une dynamique
apocalyptique, qui au nom d’une culpabilité
prétendument avérée, nous fera
demain exiger, d’abord des sacrifices, et ensuite des
punitions contre les
« tueurs »
récalcitrants.
Oui, nous produisons plus de CO2
Il est indéniable que
notre production de CO2 a énormément
augmenté en raison des excès de notre mode de vie
occidental et du gaspillage
afférent des ressources épuisables. Mais nos
excès et notre contribution au CO2
atmosphérique n’ont peut-être rien
à voir avec la survie de la planète. Or,
quiconque doute de la culpabilité humaine dans
l’évolution du climat est
immédiatement accusé de cautionner la pollution,
le gaspillage, les inégalités
et tous les maux du monde. L’état du climat
n’a rien à voir avec l’état
de la
société. On n’a jamais
résolu un problème en désignant un
bouc émissaire.
Réduire notre production de CO2 ne créera pas un
monde plus juste. Sans doute
un monde plus injuste. Le niveau de CO2 n’est pas la clef
universelle de la
régulation globale de notre société.
Les politiques doivent accepter la prise de risque
Il serait suicidaire de vouloir
bouleverser par la force de
notre volonté politique l’organisation
économique du monde au nom de ce qui
n’est que qu’une chimère, fut-elle celle
d’éminents savants en adéquation avec
nos croyances de « coupables ».
Le principe de précaution a créé
l’illusion de la possibilité d’un monde
à zéro risque, ce qui nous place de
fait dans une posture extrêmement vulnérable face
à un monde qui, contrairement
aux idées reçues, n’arrête
pas de se modifier, parfois en douceur, parfois avec
violence.
La science actuelle n’est
pas à même de répondre de
façon
précise à des questions de dynamique globale,
comme celle du climat, auxquelles
nous sommes et serons confrontées de plus en plus demain. La
constitution de
comités de scientifiques pour décréter
la
« vérité »
dont découlerait
logiquement l’action à mener est contre-productive
et dangereuse. Nous vivons
dans un monde à dynamiques multiples, non
linéaires, chaotiques et à effets de
seuils.
Dans ce contexte, le rôle
du politique est, une fois
évaluées les incertitudes, les risques, et les
avantages, de prendre des
décisions dans cette fenêtre incompressible de
flou, qui donc pourront se
révéler être erronées. Dans
ce cas, ce sera la capacité à modifier une
politique qui sera déterminante, bien plus que celle de ne
pas se tromper.
Contre le principe de précaution, c’est un
principe de prise de risque qu’il
faut élaborer. Simplement cela demande de
l’audace, de l’humilité, et surtout
d’avoir le courage d’assumer ses choix et leurs
conséquences.
CLIMATOLOGIE
30 mars 2010: L'appel d'heidelberg
 cliquez pour lire la suite cliquez pour lire la suite
A
l'heure de l'idéologisation et éco-politisation du débat climatique, voici
un texte vraiment d'actualité. L’appel d’Heidelberg a été signé en
1992 par 4 000 intellectuels, dont 3000 scientifiques et 72 prix
Nobel (Physique, Chimie, Médecine).
" Nous, soussignés,
membres de la communauté scientifique et intellectuelle internationale,
partageons les objectifs du Sommet de la Terre qui se tiendra à Rio de Janeiro
sous les auspices des Nations Unies et adhérons aux principes de la présente
déclaration. Nous exprimons la volonté de contribuer pleinement à la
préservation de notre héritage commun, la Terre.
Toutefois, nous nous inquiétons d’assister, à l’aube du vingt et unième siècle,
à l’émergence d’une idéologie irrationnelle
qui s’oppose au progrès scientifique et industriel et nuit au développement
économique et social. Nous affirmons
que l’état de nature, parfois idéalisé par des mouvements, qui ont tendance à
se référer au passé, n’existe pas et n’a probablement jamais existé depuis
l’apparition de l’homme dans la biosphère, dans la mesure où l’humanité a
toujours progressé en mettant la nature à son service et non l’inverse.
Nous adhérons totalement aux objectifs d’une écologie scientifique axée sur la
prise en compte, le contrôle et la préservation des ressources naturelles.
Toutefois nous demandons formellement par le présent appel que cette prise en
compte, ce contrôle et cette préservation soient fondés sur des critères scientifiques et non sur des préjugés irrationnels.
Nous soulignons que nombre d’activités humaines essentielles nécessitent la
manipulation de substances dangereuses ou s’exercent à proximité de ces
substances, et que le progrès et le développement reposent depuis toujours sur
une maîtrise grandissante de ces éléments hostiles, pour le bien de l’humanité.
Nous considérons par conséquent que l’écologie
scientifique n’est rien d’autre que le prolongement de ce progrès constant vers
des conditions de vie meilleures pour les générations futures. Notre
intention est d’affirmer la responsabilité et les devoirs de la Science envers
la Société dans son ensemble.
Cependant, nous mettons en garde les autorités
responsables du destin de notre planète contre toute décision qui s’appuierait
sur des arguments pseudo scientifiques ou sur des données fausses ou
inappropriées.
Nous attirons l’attention de tous sur
l’absolue nécessité d’aider les pays pauvres à atteindre une niveau de
développement durable et en harmonie avec celui du reste de la planète, de les
protéger contre des nuisances provenant de nations développées et d’éviter de
les enfermer dans un réseau d’obligations irréalistes qui compromettent à la
fois leur indépendance et leur dignité.
Les plus grands maux qui menacent notre
planète sont l’ignorance et l’oppression et non pas la science, la
technologie et l’industrie dont les instruments, dans la mesure où ils sont
gérés de façon adéquate, sont des outils indispensables qui permettront à
l’humanité de venir à bout, par elle-même et pour elle-même, de fléaux tels que
la faim et les surpopulations. "
Climatologie
 cliquez pour lire la suite cliquez pour lire la suite
Le prolongement médiatique du succès
des écologistes est anecdotique, relativement au seul
phénomène remarquable qui fut l’abstention.
En revanche, l’écho trouvé chez les leaders d’opinions, dans la presse, chez les dirigeants
politiques et économiques, intellectuels ou supposés tels, est saisissant. Face à une crise
sans précédent de la configuration de notre modèle économique, il semble que les élites
aient entrepris de divertir les esprits.
Il s’agit désormais d’être écologiquement vert-ueux et de sauver
la planète, à défaut d’organiser
équitablement la société des hommes.
Une adhésion généralisée à
l’angoisse du réchauffement climatique mobilise
aujourd’hui de nombreux esprits. La chasse aux émissions
de Co² est devenue l’alpha et l’omega de toute action
publique.
Chaque initiative politique, sociale, entrepreneuriale,
associative est désormais assujettie à cet impératif catégorique. Pourtant,
l’origine humaine du réchauffement climatique, que l’on a absorbé comme une évidence,
fait encore débat parmi les scientifiques.
Le retour massif de cet obscurantisme témoigne d’une
résignation politique sans précédent où les
peurs millénaristes se substituent peu à peu à la
Raison. Depuis quelques années, prospère et se
développe une nouvelle ère du soupçon. Ondes et
antennes-relais de téléphonie mobile, OGM,
nucléaire, réchauffement climatique : les progrès
techniques sont perçus comme autant de menaces pour
l’avenir et la bonne santé de l’humanité.
Pour aborder chacun de ces sujets, les écologistes nous
somment de faire prévaloir le principe de précaution que
l’on peut résumer ainsi : dans le doute, s’abstenir.
Malgré l’audience et la caisse de résonnance
médiatique dont bénéficie cette vogue
intellectuelle, les responsables politiques doivent raison garder.
Depuis les révolutions industrielles du XIXème siècle, le développement technique
et l’accroissement des richesses ont connu une accélération vertigineuse
qui a abouti parfois à des outrances. Pourtant, que resterait-il de Louis Pasteur et Marie Curie
si leurs recherches avaient été encadrées par le principe de précaution ?
Eut-il fallu s’abstenir lorsque l’espérance de vie
des hommes était de 39 ans dans la France de 1871 ? La
technophobie, posture intellectuellement très
confortable dans les nations développées, est une de ces
élégances inutiles, et à dire vrai souvent
dramatiques, à l’égard de peuples encore
dépourvus d’eau courante,
d’électricité, de capacités agricoles
suffisantes, d’hygiène et d’une médecine
opérante.
 cliquez pour lire la suite cliquez pour lire la suite
Le développement durable et la décroissance se feront au dépend des plus pauvres.
Les riches pourront toujours avoir recours aux indulgences pour s’offrir des « droits à polluer »,
des accords de Kyoto entre Etats aux « compensations carbone » pour les touristes.
Il faut rétablir cette vérité et
dépolluer les charmes apparents du discours écologiste :
la décroissance pour la décroissance est un
accélérateur d’inégalités entre les
peuples.
Si le modèle de surconsommation issu de l’immédiate
après-guerre, et aggravé au cours des vingt
dernières années, est une impasse, il
n’obère pas la nécessité d’une
croissance utile.
Dame Nature, désormais sanctifiée et objet de dévotion au Nord,
demeure une réalité violente et hostile au Sud.
Oublieux d’un passé qui leur a permis de domestiquer
et de maîtriser leur environnement, l’écologiste
urbain fantasme la Nature vierge – des déserts aux
forêts équatoriales – pourvu qu’ils
n’aie pas à vivre à son contact direct. Pour les
tribus africaines et les peuples de peu, cette Nature est synonyme de
précarité quotidienne : climat capricieux, animaux
sauvages, maladies…
Pour autant, nous devons nous intéresser à la question du
modèle de développement. Cette dernière
détermine de nombreux aspects de notre vie collective :
transports, agriculture, relations Nord-Sud. Même teinté
d’écologisme, le capitalisme vert est encore un
capitalisme où pourraient demain prospérer d’autres
bulles spéculatives comme le marché du Co² qui
attire d’ores et déjà les spéculateurs.
Nous devons avoir le courage d’opposer un discours
articulé, qui fasse de la recherche de
l’égalité entre les hommes et du progrès de
la civilisation une alternative sérieuse aux théoriciens
de l’Apocalypse.
Rien ne serait plus inconséquent que de
courir derrière cette idéologie dans le vent :
c’est un courant d’air !
|
 cliquez pour lire la suite
cliquez pour lire la suite