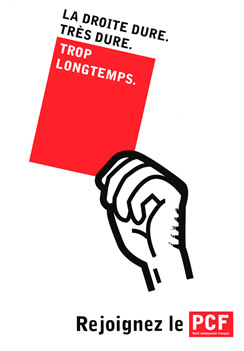|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
6 avril 2006
- La lutte contre les discriminations, grande cause nationale
- Respecter la parole des jeunes La jeunesse n’est pas respectée. Sur des questions essentielles pour son présent et son avenir, elle n’est même pas consultée. Nous proposons de construire dans un grand débat public une loi d’orientation pour la jeunesse. Sans attendre, des lieux de parole et de pouvoirs à tous les niveaux, y compris institutionnels, doivent les associer aux décisions. Nous proposons de créer une allocation et un service public permettant d’accompagner vers leur autonomie les jeunes dans leur diversité de situation. Des actions doivent être engagées contre toutes les formes de discriminations qu’ils subissent. - La laïcité, un acquis à revivifier La laïcité est la condition même du « vivre ensemble ». Pour nous, non seulement elle assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes, mais elle est l’un des fondements d’une société d’égalité des droits entre tous les individus. Ses principes ne sont pas compatibles avec les discriminations, les intégrismes, et les communautarismes.
Nous proposons la création d’un Haut conseil de la laïcité , dont le rôle serait de faire vivre ses principes dans les conditions du 21ème siècle. - Reconnaître enfin les droits des migrants L’exploitation et le racisme dont sont victimes les travailleurs migrants et leurs familles sont insupportables. La France doit être porteuse de
l’exigence impérative de transformations
économiques internationales permettant de
faire cesser le pillage des pays d’origine, y compris de
leurs cadres ou de leurs élites et de faire reculer
l’exode de la misère.
Il
faut supprimer la notion de « pays
sûrs » qui permet de traiter une demande
d’asile par procédure prioritaire, sans un examen
approfondi du dossier. Le droit de vote et d’éligibilité est accordé à toutes les élections (après trois ans de résidence pour les élections locales, dix ans pour les élections nationales). 6
avril 2006 2006
- une société de mixité Favoriser partout la mixité en s’opposant à tout ce qui divise ou sépare - Pour l’égalité professionnelle Dès le début de la législature, après évaluation des lois existantes, les mesures législatives nécessaires seront prises pour une réelle mise en œuvre de cette égalité (accès à l’emploi, salaires, promotions,...). Elles obligeraient à négocier tous ans sur les mesures permettant de faire respecter l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, avec obligation de résultats et droit à la réparation des discriminations antérieures. Des sanctions financières seront appliquées si les écarts ne se réduisent pas véritablement. Elle organiserait la transparence des indicateurs d’évaluation de l’égalité, et créerait un pouvoir de décision des représentant -e -s du personnel, ou à défaut les salarié-es, sur la mise en place et les modalités d’horaires à temps partiel. Elle ferait des atteintes à l’égalité professionnelle une discrimination punissable pénalement. . - le libre choix de sa maternité Garantir le droit à une maternité voulue, associée aux congés parentaux des deux parents. Garantir le droit à l’information sur la contraception. Rembourser à 100% tous les modes de contraception. Programme de santé publique garantissant le droit à l’IVG et sa gratuité, avec le développement des centres de planning familial. Combat contre toutes les restrictions de ces droits au plan national et européen. - le refus de toutes les formes de violence :
Les migrants : le monde en
mouvement
La
lutte contre les discriminations doit être menée
avec l’ampleur et la volonté nécessaire
afin de corriger les inégalités, les exclusions.
Elle implique une détermination politique pour le respect
des droits fondamentaux, le rétablissement de
l’égalité.
Par Commission migrations - droits des
migrants - 31 mars 2006 2006
Nous proposons :
Il faut renforcer les lois et les moyens pour la lutte contre les discriminations, contre le racisme, la xénophobie. La pratique de l’égalité de traitement, entre nationaux et étrangers, suppose de travailler sur la répression des comportements discriminatoires quels qu’ils soient et où que ce soit. Elle suppose, dés aujourd’hui, la levée de l’ensemble des discriminations affectant le recrutement des travailleurs étrangers, et celles concernant les migrants retraités. L’interdiction de certains emplois aux étrangers date du XIXe siècle. Elle ressurgit dans les périodes de crise économique, s’appuyant sur l’idée erronée selon laquelle que le chômage s’explique par l’excès de main-d’oeuvre. À partir de 1981, la loi Auroux interdit, théoriquement, toute forme de discrimination liée à la nationalité en matière d’embauche et de licenciement. Récemment, les obstacles à l’emploi des étrangers européens ont été assouplis, leur ouvrant notamment l’accès à certains corps de la fonction publique et territoriale, près de 70% des emplois (loi du 26 Juillet 1991). La cohérence de nos propositions permet de lutter contre les statuts précaires, d’infra droit et de sous salaires Les principes qui “justifient” l’existence d’emplois fermés, dans la fonction publique deviennent inopérants. Des étrangers, non communautaires, sont salariés en nombre dans la fonction publique en tant que contractuels, auxiliaires ou vacataires. Une première étape consisterait à aligner le statut de l’ensemble des étrangers sur celui des ressortissants de l’Union européenne. En donnée chiffrée, 7 millions d’emplois sont fermés aux étrangers non communautaires, soit près d’un emploi sur trois, parmi lesquels 1,2 million dans le secteur privé et plus de 5 millions dans le secteur public. Par contre, seuls 1,8 million d’emplois sont interdits aux travailleurs de l’Union européenne Nous proposons :
Alors que l’on intime aux migrants un “devoir d’intégration” les moyens dévolus pour y parvenir diminuent. Ainsi les sommes allouées aux associations aidant à l’apprentissage du Français diminuent. La notion même d’intégration nous renvoie à une conception idéologique discutable. La pression de l’idéologie dominante et la violence symbolique véhiculée par cette notion cantonne des personnes dans une situation d’ou il ne peuvent jamais sortir. On peut parler d’intégration en constatant, qu’alors, ce n’était seulement plus l’étranger qui “s’adapte”, mais que la société se métisse. La réussite de toute politique future de “l’immigration” et de “l’intégration”, d’une politique progressiste, antilibérale vis-à-vis des migrants repose donc pour une part importante sur la sensibilisation et la mobilisation de notre peuple, l’évolution de son regard sur l’immigration et les immigrés, une meilleure connaissance de ce que nous devons ou non à l’immigration d’hier et d’aujourd’hui et de ce qu’elle peut nous apporter, historiquement, socialement, culturellement, économiquement. Nous proposons :
Principe d’égalité de traitement Les discriminations font des dégâts alors que le modèle républicain français continue d’affirmer que “les hommes naissent libres et égaux en droits”. Ces discriminations sont largement sous estimées. Il est nécessaire de prendre à bras le corps le besoin d’égalité qui s’exprime ardemment dans notre société. Le “contrat d’accueil et d’intégration” ? Ce nouveau dispositif, défini par Jacques Chirac - discours du 4 octobre 2002 - s’adresse aux primo-arrivants pour l’acquisition du titre de séjour et impose des contraintes d’ordre scolaire et professionnel pour les enfants de migrants qui souvent sont nés en France et y vivent depuis de nombreuses années. Ils - elles - sont tenus d’assurer une maîtrise de la langue française et doivent prouver une aptitude à acquérir les codes et les valeurs qui font corps à une France républicaine et laïque. L’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM), nouvellement crée, fusion de l’Office des migrations Internationales (OMI) et du Service social d’aide aux émigrants (SSAE), financée par une partie importante du budget du FASILD, se met en place pour le financement de ce contrat. Ce dispositif grève le budget du FASILD, seul organisme chargé jusqu’ici de redistribuer des fonds, en partie versés par les migrants, aux associations qui mènent une pratique conséquente d’aide à l’insertion et à la formation des migrants. En procédant par tri sélectif sur les bons et mauvais migrants, ce contrat, tel qu’envisagé, anticipe sur les termes d’une politique des quotas visée par le gouvernement. Le montant des subventions versées aux acteurs de “l’intégration” n’a cessé de décroître. Il est passé de 193 millions d’euros en 1992 à 147 millions d’euros en 2004. La “discrimination positive” ? Nous rejetons la notion de “discrimination positive”. Il n’est pas innocent d’observer que c’est une traduction déformée du concept américain de “positives actions”. La discrimination positive, supposée en finir avec des inégalités, ne fait que décaler celles ci en ne s’appliquant qu’à quelques migrants et à des Français dits “d’origine”. Les critères d’application sont fondés sur le “groupe ethnique” et non plus sur des critères sociaux, sur le droit à l’égalité. C ’est reconnaître des individus dans une “spécificité ethnique, religieuse ou culturelle” qui a pour effet d’étouffer les aspirations à l’égalité réelle. De plus, il ne peut être question de se limiter à quelques “réparations”, pour nécessaire et utiles qu’elles puissent être, tout en faisant l’impasse sur l’objectif d’une politique re-distributive, d’une politique d’égalité réelle et de justice sociale C’est à ce titre, et dans ce cadre, que des mesures correctives immédiates peuvent et doivent être prises. Nous
refusons donc de reprendre cette notion de “discrimination
positive”. De plus, posons la question : aurait-il
des “discriminations négatives”, moins
négatives que d’autres ? La question est : quelles sont les politiques à mettre en oeuvre pour mettre un terme aux discriminations, toutes “négatives”. Établir une politique en fonction de la couleur de la peau, de l’origine, est incompatible avec les principes de la République, avec le principe d’égalité. Pour autant il faut lutter contre les discriminations, et contre les effets des discriminations, des ségrégations. C’est une question de justice sociale. Aux mesures énoncées auparavant, nous ajoutons d’autres mesures correctives, fondées sur des critères sociaux, sur l’égalité, sur la justice :
Il s’agit donc de passer d’une égalité de façade à une égalité d’émancipation. Affirmer une volonté politique à l’échelle de toute la société qui pourrait se traduire par une véritable campagne nationale. NB : Les gens du voyage, qui pour l’essentiel sont Français, bénéficieraient aussi d’une telle politique, ils se verraient réellement reconnus à égalité de droit. La minorité Rom doit être reconnue. |
|||
|
|